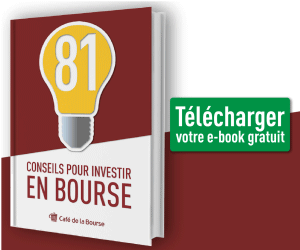Dans un contexte de remise en cause du capitalisme financier traditionnel, l’Investissement Socialement Responsable, qu’on désigne habituellement par son acronyme ISR ou par l’une de ses variantes telles que l’Investissement Durable ou l’Investissement Soutenable, a le vent en poupe.
Après une longue période d’indifférence vis-à-vis de ce qu’il faut bien appeler un OFNI (Objet Financier Non Identifié), tous les grands gestionnaires de fonds de la place s’y mettent : fonds ISR monétaires, SICAV “actions durables” , OPCI soutenables, etc. De grands gérants institutionnels comme La Banque Postale AM ou Crédit Agricole Asset Management (CAAM) ambitionnent de devenir des leaders en France sur le marché de l’ISR. Des acteurs de petite taille comme l’UFG, filiale de gestion du groupe Crédit Mutuel Nord Europe, jusqu’à présent surtout connue pour son portefeuille d’actifs immobiliers, se glissent aussi dans la brèche et mettent en avant leur offre ISR pour se faire connaître.

Cet engouement des gestionnaires se répercute mécaniquement sur les courtiers en valeurs mobilières, les brokers, dont le métier consiste à “vendre”, au sens propre comme au figuré, les actions et obligations des sociétés cotées. Ainsi, des courtiers indépendants comme Oddo ont très tôt détecté le potentiel que pouvait représenter l’ISR pour doper leur chiffre d’affaires, et ont constitué des équipes dédiées à cette thématique. Ils ont été imités peu ou prou par tous les autres courtiers qui basent leur recherche ISR, soit sur des méthodologies propriétaires, donc opaques et difficilement comparables, soit sur des grilles d’analyse issues des agences de notation extra-financière.
Ces agences comme VَIGEO, présidée par l’hyper-active ex-secrétaire générale de la CFDT, Nicole Notat, constituent en effet le troisième pilier de cet industrie financière naissance. L’ISR représente du pain béni pour VIGEO dont l’actionnariat est composé à hauteur de 45% de grands gestionnaires financiers (Caisses d’Epargne, Crédit Agricole Asset Management, Société Générale Asset Management, etc..), à hauteur de 27% de grandes entreprises (on y retrouve les plus grandes valeurs du CAC 40), et à 28% de divers syndicats à tradition réformiste dont fait partie la CFDT. Le tryptique “actionnaire, patron, syndicaliste” et la culture du consensus social, issue du syndicalisme réformiste, fondent ainsi le “business modèle” de VIGEO et lui apportent une certaine légitimité.

Mais on peut néanmoins s’interroger sur l’indépendance réelle de cette agence vis-à-vis de ses actionnaires puissants qui sont, par la force des choses, aussi ses grands donneurs d’ordres. Quelle crédit accorder à un rapport élogieux sur Total lorsque l’on sait que le groupe pétrolier est l’un des actionnaires ? Que vaut le label VIGEO apposé sur un fonds ISR promu par CAAM ou SGAM également actionnaires de l’agence ? La crise des subprimes a montré les limites des agences notation payées par les entreprises qu’elles sont censées noter, et a mis à jour leur responsabilité, ou plutôt leur irresponsabilité flagrante, pour avoir formulé des jugements à l’emporte-pièce sur des actifs financiers qui se sont révélés pourris.
L’ISR soulève aussi d’autres problèmes encore plus gênants. Personne n’est vraiment capable de fournir une définition rigoureuse de cette approche ou “philosophie” de gestion pour la bonne et simple raison qu’il n’en existe pas. A la base, l’ISR repose sur une sélection de valeurs (actions, obligations) fondée sur des critères extra-financiers supposés apporter un “supplément d’âme” : valeurs sociales, environnementales et de bonne gouvernance. Mais il n’existe pas de méthodologie universellement admise, contrairement aux labels qualité ISO par exemple, pour qualifier le bon respect par l’entreprise émettrice de ces différents critères, et surtout pour apprécier la pondération et la hiérarchie des différents critères au sein d’une note globale. Les Suisses privilégient ainsi depuis longtemps les critères liés à l’environnement sans se soucier outre mesure de la politique sociale de l’entreprise. A l’inverse, les anglo-saxons mettent surtout l’accent sur la “corporate governance“ ou gouvernance d’entreprise à travers la mise en place de comités d’audit et de rémunération indépendants. Enfin, en France, on accorde traditionnellement plus d’importance aux critères sociaux, surtout depuis la loi NRE (Nouvelles Régulations Economiques) de 2001 qui impose aux entreprises cotées de publier un rapport social et environnemental. Au niveau international une réflexion a bien été engagée, notamment par l’ONU et ses diverses agences spécialisées, pour apporter un peu plus de clarté dans ce “flou artistique”. Mais rien de concret n’en est sorti, les grands lobbys financiers voyant d’un mauvais œil la définition d’un standard ouvert et transparent, équivalent pour la finance aux logiciels libres de l’informatique, qui remettrait en cause le bien fondé des commissions parfois exorbitantes demandées aux épargnants en échange d’une supposée expertise.

Un autre symptôme du manque de maturité de l’ISR est l’accent mis par les promoteurs des fonds tantôt sur la valeur éthique de la démarche, le fameux “supplément d’âme”, tantôt sur l’hypothétique surplus de performance financière généré à plus ou moins long terme par les fonds labellisés ISR. Comme le montrent bien Jacques Crémer et Christian Gollier, chercheurs en économie à l’Université de Toulouse, dans un récent point de vue publié par le journal Les Echos, “ce double discours, à la fois utopiste et vénal, trouble les épargnants dont les motivations altruistes sont contrées par la publicité sur la surperformance alors que cette dernière cherche à flatter les motivations opportunistes des autres“. Les gestionnaires ne savent plus sur quel pied danser pour vendre leur fonds ISR, au risque d’étouffer cette nouvelle poule aux œufs d’or. D’autant que d’après les études académiques les plus sérieuses, voir à ce sujet, Investing in Socially Responsible Funds de Christopher Geczy, Robert Stambaugh et David Levin (2003) et The price of Ethics : Evidence from Socially Responsible Mutual Funds de Luc Renneboog, Jenke Horst, Chendi Zhang (2007) , l’investissement socialement responsable, ou durable, a bel et bien un coût en terme de moins-value financière par rapport à un investissement dans un fonds classique. Ce coût peut même atteindre jusqu’à 5% de rendement en moins par an.
Cette analyse succinte montre qu’il faut sortir d’une certaine forme d’hypocrisie par rapport au prix réel qu’on attache aux critères extra-financiers et à un modèle de croissance économique durable, fondé sur des considérations qualitatives plus que quantitatives. On ne sortira du paradoxe de l’ISR qu’en attribuant une valeur, donc un prix, à des critères tels que la qualité de la vie, la solidarité inter-générationnelle ou la limitation de l’utilisation des ressources naturelles. L’ISR ne s’imposera vraiment dans le portefeuille des épargnants que quand il aura réussi sa mue et qu’il aura gagné le cœur et la raison des citoyens. Il aura alors imprégné complètement tout la sphère économique et financière et il n y aura plus de raison pour attribuer une rémunération supplémentaire, autrement dit un surprofit, à un gestionnaire d’actifs en échange d’une expertise particulière sur ce thème. Ce n’est pas là le moindre des paradoxes de l’ISR : sa généralisation devrait conduire inexorablement à sa disparition, dans un processus de destruction créatrice finalement très caractéristique de l’économie capitaliste !
Alexandre Kateb
 Newsletter
Newsletter  Ebook
Ebook  Lexique
Lexique  Outils
Outils  Vidéos
Vidéos  Formation
Formation